Études de santé : comment préserver sa santé mentale ?
.png)
Que l’on s’y prépare ou que l’on y soit déjà, les études de santé peuvent avoir un impact significatif sur la santé mentale. Il est donc crucial de savoir en repérer les signes pour pouvoir prendre des mesures et préserver son bien-être psychologique tout au long de ce parcours exigeant.
Cet article propose d’étudier les signes alarmants de détérioration de la santé mentale à repérer chez soi ou chez les autres, des habitudes à mettre en place pour prévenir la détresse psychologique, ainsi que des solutions pratiques et des ressources pour se préserver et trouver du soutien en cas de besoin.
L'ampleur du problème
Une étude de l'Inserm menée en 2021 sur près de 12 000 étudiant•es en médecine français•es (soit environ 15 % des étudiant•es en médecine de l’hexagone) a révélé des statistiques alarmantes concernant la santé mentale dans cette branche des études supérieures. Selon l’Inserm, plus de 25 % des personnes interrogées déclarent avoir subi un épisode dépressif majeur au cours de l’année écoulée, et plus de 50 % souffrent de détresse psychologique modérée à sévère (anxiété, dépression, pensées suicidaires). 67 % des internes sont également touché•es par le burnout (contre 39 % pour les étudiant•es pré-internat). La dégradation de la santé mentale est donc un sujet majeur de la vie des étudiant•es en santé et il est crucial d’en comprendre les causes et les impacts pour pouvoir s’en préserver.
Les facteurs de risque
Si les étudiant•es en santé subissent les mêmes problématiques que les autres étudiant•es de France (précarité étudiante, contexte géopolitique global incertain et anxiogène, etc.), ils et elles font également face à un grand nombre de facteurs de risques propres à leur cursus universitaire.
En première année, l’ennemi numéro un reste l’isolement social. Ce sentiment de solitude s’est considérablement amplifié depuis la crise sanitaire du Covid19, notamment parce qu’une majorité des cours de première année sont toujours, à l’heure actuelle, dispensés par visioconférence, mais aussi parce que la pression académique toujours plus forte et la charge de travail associée génèrent à elles seules beaucoup d’anxiété et ne favorisent ni l'entretien ni la création de liens sociaux.
Passée la première année, d’autres facteurs de stress viennent s’ajouter à ceux cités précédemment, liés notamment à des conditions de travail précaires : le manque de moyens financiers alloués au domaine de la santé, le nombre d’heures hebdomadaires souvent largement supérieur à la limite autorisée en théorie ou encore le harcèlement et les violences psychologiques, sexistes et sexuelles (dont environ 25 % des personnes interrogées par l’Inserm déclarent avoir été victimes) sont une réalité pour beaucoup et ont un impact non négligeable sur la santé mentale.
Enfin, le nombre important de réformes imposées aux étudiant•es en médecine, dont certaines n’ont pas toujours l’effet escompté, a aussi un rôle à jouer dans la détérioration de la santé mentale estudiantine. C’est le cas par exemple de la réforme du 3e cycle dont “l’objectif principal était la professionnalisation de la formation permettant aux jeunes médecins de s’installer comme médecin spécialiste dès l’obtention de leur diplôme d’études spécialisées (DES)”. Dans la réalité, les étudiant•es en 6e année de médecine se retrouvent dans une situation d’incertitude face à leur avenir, car la réforme ne garantit plus l’accès à une spécialité et encore moins à la spécialité dans laquelle s’est projeté l’étudiant•e depuis 6 ans. C’est également au dernier moment que chacun et chacune aura connaissance de la spécialité qui lui a été attribuée (parfois complètement différente du choix de base), ainsi que du lieu où exercer, générant ainsi un fort sentiment d’incertitude, d'impuissance et d'anxiété pour ces jeunes adultes en pleine construction de leur futur.
Repérer les signes de détresse
Pour pouvoir prendre soin de soi et des autres, il est essentiel de reconnaître les signes indiquant un état de détresse psychologique. Parmi les signes à surveiller, on trouve notamment :
- Des changements d'humeur soudains ou extrêmes ;
- Un isolement social ;
- Des difficultés à se concentrer ;
- Des difficultés à dormir ou au contraire une tendance à dormir beaucoup plus ;
- Une perte d'intérêt pour les activités autrefois appréciées (allant parfois jusqu’à l’abandon des études en cours) ;
- Un sentiment d'anxiété, de tristesse ou de dépression persistant ;
- Une augmentation des comportements auto-dommageables (consommation d'alcool ou de drogues, mise en danger de soi et/ou d’autrui, violence, mutilations, etc.) ;
- Une tendance à se mettre en retrait et à s’isoler (se retirer des réseaux sociaux, s’isoler de son cercle amical/familial, annuler fréquemment des rendez-vous…) ;
- Une diminution importante de l’estime de soi.
Il peut arriver que des personnes présentent certains de ces signes isolément ou de manière transitoire, ce qui peut être une réaction normale après un choc émotionnel (une rupture, un décès, etc.). Il est cependant important d’être attentif•ve en cas d’apparition soudaine et sans raison apparente de plusieurs de ces symptômes (voire tous en même temps), surtout s’ils apparaissent chez des personnes fragiles ou déjà sujettes à des soucis de santé mentale.
Préserver sa santé mentale
Une bonne santé mentale découle d’un équilibre entre les aspects émotionnels, physiques, financiers, sociaux, et mentaux de la vie d’un individu. Pour préserver cet équilibre dès le départ, il est possible d’intégrer quelques habitudes et routines dans son planning hebdomadaire. Voici quelques pistes :
- Pratiquer une activité sportive régulière (une à deux fois par semaine minimum) ;
- Bouger tous les jours (marcher, faire des exercices de mobilité, passer du temps dans la nature, etc.) ;
- Manger sainement et régulièrement ;
- Boire suffisamment d’eau sur la journée ;
- Dormir assez et d’un sommeil de bonne qualité ;
- Réduire, stopper et/ou réguler sa consommation d’alcool, drogues, tabac, stimulants (caféine, sodas, etc.) ;
- Entretenir un réseau social : créer des liens avec d’autres étudiant•es en santé mais aussi entretenir les liens avec l’environnement hors études de santé (cercles d’ami•es plus anciens ou venant d’autres facs, famille, etc.) ;
- Chercher de l’aide en cas de problèmes financiers, de logement, ou autre.
Trouver de l’aide
Il existe plusieurs types de ressources disponibles pour les étudiant•es (en santé ou non) :
Les bureaux d'aide psychologique universitaires (BAPU)
Disponibles dans la plupart des cités universitaires, les BAPU proposent des consultations avec des psychothérapeutes et acteur•ices du domaine social prises en charge à 100 % par la Sécurité sociale et les mutuelles (sans avance de frais et avec un nombre de séances illimitées tant que les étudiant•es en ressentent le besoin).
Les associations étudiantes
Présentes dans presque toutes les hautes écoles et universités, les associations étudiantes peuvent offrir un soutien émotionnel, aident à créer des liens sociaux pour lutter contre l’isolement et peuvent mettre en relation des étudiant•es de différentes années, permettant ainsi de partager des conseils et des expériences vécues.
Les organismes
Il existe un grand nombre de permanences téléphoniques ou de messageries proposant un soutien psychologique gratuit et anonyme pour les étudiant•es. En voici quelques exemples :
- L’entraide Ordinale qui propose une assistance gratuite pour les soignant•es, médecins et internes en médecine, par des psychologues ou des médecins au 0 800 288 038 ;
- Santé Psy Étudiant qui permet de solliciter l'aide d'un•e psychologue et de bénéficier de huit séances gratuites, sans avance de frais et renouvelables ;
- Nightline qui est une association spécialiste des questions de santé mentale proposant aux étudiant•es des lignes d'écoute ainsi qu'une messagerie en fonction de leur région d’étude ;
- La Cnaé qui est une ligne d’écoute professionnelle proposée à toutes les étudiantes et tous les étudiants qui recherchent une aide concrète sans forcément savoir à qui s'adresser en priorité au 0 800 737 800 ;
- Le 3114, le Numéro National de Prévention du Suicide qui est gratuit, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et permet aux personnes en détresse psychologique d’échanger et de trouver une réponse adaptée auprès de professionnel•les de la psychiatrie et de la santé mentale (psychiatres, infirmiers/infirmières et psychologues) ;
- Le Collectif Féministe Contre le Viol qui vise à aider et soutenir toutes les personnes victimes de violences et d’agressions sexuelles, sous toutes ses formes (viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel) au 0 800 05 95 95 du lundi au vendredi, de 10 h à 19h ;
- Il existe également d’autres lignes dédiées aux victimes de violences, à l’addiction, au deuil ou à d’autres événements pouvant affecter la santé mentale.
Les professionnel•les de la santé mentale
Il est important de ne pas sous-estimer l'importance de consulter régulièrement un•e professionnel•le de la santé mentale en cas de besoin : c’est souvent une étape nécessaire pour réussir à se rééquilibrer et retrouver un bien-être émotionnel. Il n’est cependant pas nécessaire d’attendre le point de non-retour pour consulter, car les suivis psychologiques peuvent bénéficier à toute personne qui souhaite prendre soin de sa santé mentale et se connaître un peu mieux, sans forcément être en état de détresse psychologique.
Les aides alimentaires et aides au logement
La plupart des grandes villes de France possèdent des organismes et associations dont le but est de permettre aux étudiant•es et personnes précarisées de se nourrir et de se loger. Renseignez-vous auprès de votre école ou des services de votre ville pour découvrir les aides disponibles près de chez vous.
En conclusion, les questions de santé mentale concernent tout le monde et il n’y aucune honte à faire face à la détresse psychologique : reconnaître ses propres limites et chercher de l'aide est un signe de force, et c’est en travaillant ensemble pour briser les stigmates entourant la santé mentale que nous pourrons créer un environnement plus favorable où chacun•e se sent bien et libre de rechercher le soutien dont il ou elle a besoin.
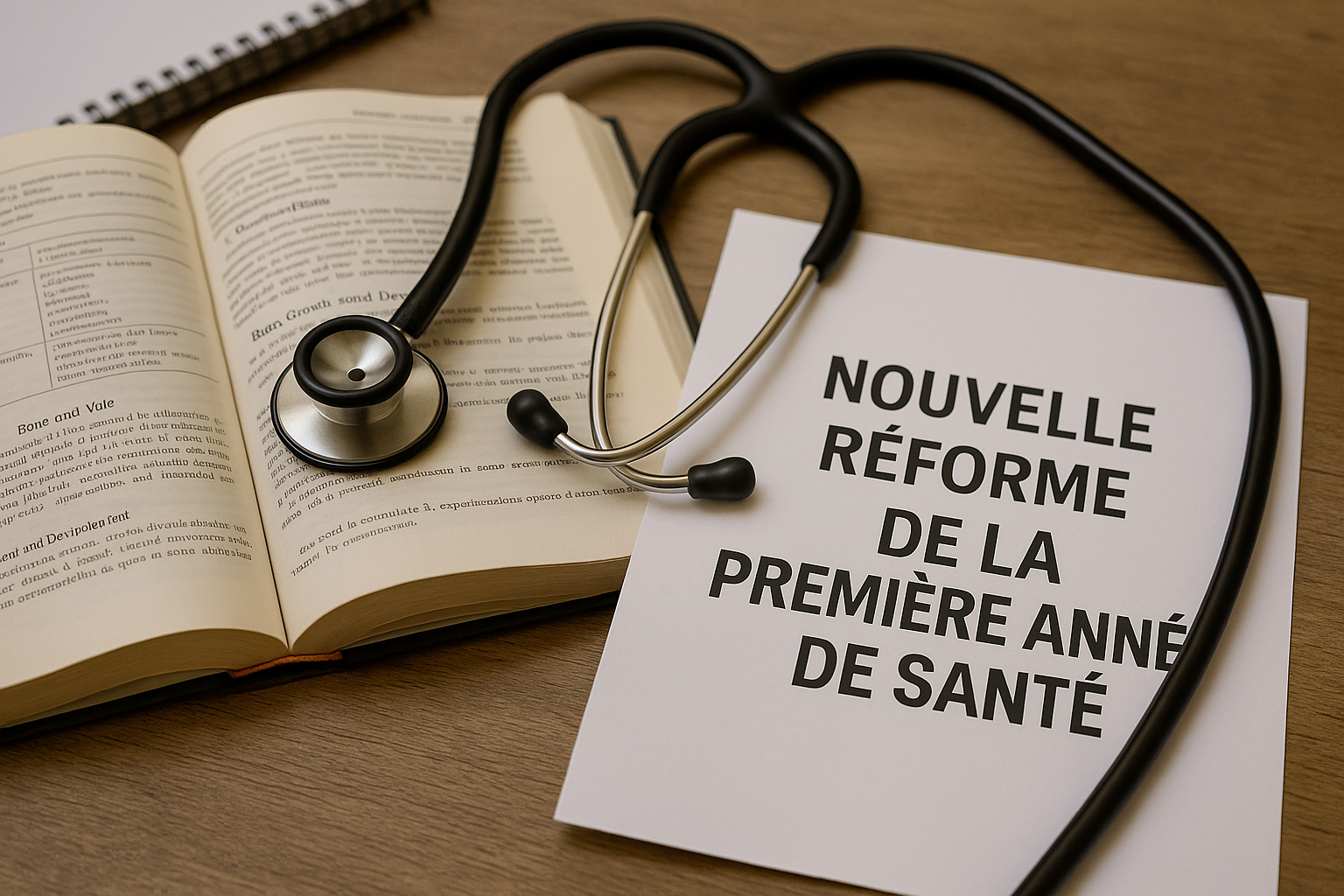
Vers une nouvelle réforme ?
Le 20 octobre 2025, le Sénat a adopté en première lecture une proposition de loi visant à réorganiser la première année de santé. Cette réforme cherche à répondre aux limites du système PASS-LAS-SpS mis en place en 2019, jugé complexe et peu lisible pour les étudiants et leurs parents.
Voici les principaux changements envisagés.
Une voie unique d’accès
La réforme propose la fin du système PASS-LAS-SpS au profit d’une seule licence universitaire.
La première année comporterait majoritairement des enseignements en santé, et toujours une discipline hors santé choisie dans un catalogue restreint qu'aujourd'hui.
L’objectif est double : simplifier et clarifier le parcours d’accès pour les étudiants, tout en réinstaurant une cohérence nationale dans les critères d’admission aux filières médicales.
Un accès expérimental en pharmacie via Parcoursup
Le texte prévoit également que, dans la limite d’un tiers des capacités d’accueil, l’entrée en première année d’études de pharmacie puisse se faire directement via Parcoursup, à titre expérimental. Cela permettrait de diversifier les profils d’étudiants, en s’appuyant sur une sélection au niveau du lycée.
Une première année sur tout le territoire
Pour mieux répartir les futurs professionnels de santé, la proposition de loi prévoit l’organisation d’une première année d’accès aux études de santé dans chaque département.
Elle étend en outre à l’ensemble du territoire l’expérimentation d’options santé dans les lycées situés en zones sous-denses, afin d’encourager les vocations locales.
Rentrée 2027
La réforme doit maintenant être examinée par l’Assemblée nationale. Si elle est adoptée dans les prochains mois, son application pourrait intervenir à partir de la rentrée universitaire 2027.

À savoir avant de se lancer en médecine
Faire médecine, ce n’est pas seulement aimer les sciences ou vouloir aider. C’est accepter un parcours long, avec des périodes de fatigue, de doute, de pression. On commence tôt à l’hôpital, on prend des responsabilités progressivement, on joue une partie de son avenir lors des EDN et ECOS. Mais c’est aussi un chemin qui donne du sens : celui d’apprendre un métier profondément humain.
Les six premières années : un parcours commun et encadré
Généraliste, chirurgien, pédiatre… peu importe la spécialité, tous les étudiants commencent par une première année très sélective : la PASS, la LAS ou parfois la SpS selon les facultés. Ceux qui réussissent accèdent ensuite aux deux années suivantes, encore assez théoriques. On y apprend le fonctionnement du corps, les organes, les maladies, la pharmacologie, et c’est aussi le moment où se posent les bases médicales communes.
Les premiers pas à l’hôpital arrivent généralement en deuxième ou troisième année, sous forme de stages d’observation. On découvre les services, leur organisation, les patients…
Puis, à partir de la quatrième année, on devient externe. À ce stade, on partage son temps entre les cours à la fac et les stages à l’hôpital. On commence à interroger des patients, à réaliser des examens simples, à rédiger des comptes-rendus et à participer à la vie des services. C’est là une vraie immersion dans le quotidien du soin.
Les EDN et les ECOS : l’étape décisive
En octobre de la sixième année arrivent les EDN (épreuves écrites) suivis en mai des ECOS (épreuves pratiques).
Les EDN testent les connaissances et la façon de raisonner face à des situations médicales. Les ECOS, eux, sont des mises en situation : on joue une consultation avec un patient simulé, on doit poser les bonnes questions, examiner, expliquer, parfois rassurer.
Ces deux examens donnent un classement national. Et ce classement détermine deux éléments essentiels : la spécialité que l’on pourra exercer et la ville dans laquelle on effectuera la suite de sa formation. C’est pourquoi cette période est souvent l’une des plus stressantes des études.
L’internat : apprendre le métier, vraiment
Après les résultats, chaque étudiant choisit sa spécialité et sa ville. C’est l’entrée dans l’internat. À ce moment-là, on devient médecin en formation, salarié de l’hôpital. On soigne vraiment, on prend des décisions, on fait des gardes, mais toujours sous la supervision de médecins plus expérimentés.
L’internat dure entre quatre et six ans selon la spécialité. Il se termine par la rédaction d’une thèse. Une fois soutenue, on obtient officiellement le titre de docteur en médecine.
Ce que disent les étudiants
Au-delà des chiffres et des étapes, ce sont souvent les témoignages d’étudiants qui permettent de comprendre la réalité du parcours. Beaucoup racontent le choc de la première garde, le stress des EDN, mais aussi l’annonce d'un diagnostic ou le fait de rassurer un patient.

Dans les témoignages, on découvre que chacun vit ses études différemment : certains trouvent leur équilibre rapidement, d’autres doutent, beaucoup s’accrochent grâce à leur passion ou à leur équipe de stage. Ces récits permettent de réaliser que médecine n’est pas seulement un cursus, mais une expérience profondément humaine, partagée par des milliers d’étudiants chaque année.
Ces témoignages sont à écouter dans le medCast.
À retrouver sur Spotify, Apple Podcast ou sur YouTube.

Adopter des routines efficaces pour réussir les études de santé
Adopter des routines efficaces pour réussir les études de santé
En première année de santé, une bonne méthodologie est essentielle. L’équipe pédagogique de medForma a mis en place un système de planification hebdomadaire pour aider les étudiant·e·s à structurer leur emploi du temps de manière réaliste et efficace. Les routines du vendredi et du dimanche sont des moments clés de cette planification, où les élèves prennent du recul et organisent la semaine à venir.
Prendre du recul et anticiper
La routine du vendredi consiste à prendre du recul sur la semaine écoulée, faire le point sur les cours qui n’ont pas encore été travaillés ou qui ont posé des difficultés et organiser le travail du week-end en conséquence. Cela permet de prioriser les tâches et de se mettre à jour.
La routine du dimanche soir a pour objectif d’organiser la semaine à venir, de planifier et donc préparer les TDs ou encore de programmer la colle et le créneau de remédiation. C’est aussi le moment de vérifier les informations de la faculté, telles que les horaires, les modifications éventuelles du planning ou les nouveaux devoirs. Ainsi l'étudiant·e, peut débuter la semaine suivante sans stress et avec une vision claire des objectifs.
L’importance de la régularité
Comme le souligne Cécile Tritschler, enseignante en physique et directrice de formaScience : “La régularité dans la planification hebdomadaire est un facteur clé de succès. Lorsqu'on a une routine bien installée, les tâches deviennent plus gérables, et les semaines passent plus sereinement.” Ainsi, plus l’élève sera régulier·ère dans son organisation, moins il·elle se sentira perdu·e ou submergé·e par la charge de travail. Cela permet de prendre de bonnes habitudes non seulement pour la première année de santé mais également pour la suite du cursus.



